« Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Telle pourrait être la morale du livre que vient d’écrire le radiologue Bernard Duperray, un ouvrage à placer entre les mains de toutes les femmes. Non, le dépistage du cancer du sein ne sauve pas des vies contrairement à ce que ses promoteurs affirment. C’est pourquoi le dépistage de masse entraîne, encore et toujours, un phénomène de surdiagnostic et une médicalisation inutile de milliers de femmes. Pourquoi tant d’aveuglement ? Parce que l’échec du dépistage du cancer du sein balaye tous les dogmes autour de cette maladie : tout cancer du sein dépisté n’est pas forcément évolutif, et de nombreux cancers restent silencieux. Il est grand temps pour les autorités sanitaires de revoir leurs prescriptions et de cesser de stresser les femmes avec la propagande d’Octobre Rose. Propos recueillis par Pryska Ducœurjoly pour Néo Santé N°93, octobre 2019
Un parcours, une expérience
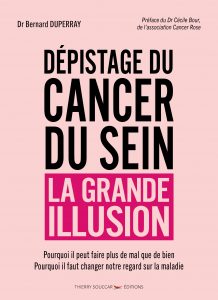 Bernard Duperray a vécu de l’intérieur l’histoire du dépistage du cancer du sein. Après avoir lu près de 200.000 mammographies, diagnostiqué des milliers de cancers du sein, participé à des dépistages expérimentaux dans le cadre de l’étude française SU.VI.MAX et dans le département pilote de l’Oise, ce radiologue et sénologue (spécialiste du sein) raconte comment il est passé de l’espoir à la désillusion. En 1995 il démissionne de ses fonctions de responsable dans cette opération de santé publique et cesse d’y participer. Dans « Dépistage du cancer du sein, la grande illusion », Bernard Duperray tire les leçons d’un échec annoncé.
Bernard Duperray a vécu de l’intérieur l’histoire du dépistage du cancer du sein. Après avoir lu près de 200.000 mammographies, diagnostiqué des milliers de cancers du sein, participé à des dépistages expérimentaux dans le cadre de l’étude française SU.VI.MAX et dans le département pilote de l’Oise, ce radiologue et sénologue (spécialiste du sein) raconte comment il est passé de l’espoir à la désillusion. En 1995 il démissionne de ses fonctions de responsable dans cette opération de santé publique et cesse d’y participer. Dans « Dépistage du cancer du sein, la grande illusion », Bernard Duperray tire les leçons d’un échec annoncé.
Votre livre est un nouveau pavé dans la mare du dépistage. Qu’apporte-t-il de nouveau ?
Bernard Duperray. L’inefficacité du dépistage du cancer du sein est désormais connue. Le dépistage a permis de trouver des lésions plus petites mais il n’a pas fait baisser le nombre de cancers avancés et n’a pas eu d’effet positif sur la mortalité. Un diagnostic plus précoce grâce au dépistage s’est révélé inefficace et même contreproductif. En effet, en favorisant le surdiagnostic, le dépistage s’est avéré être une machine à générer de la maladie, constatation surréaliste pour une opération de santé publique. Mais ce qui est encore plus difficile à admettre, c’est qu’il apporte la preuve expérimentale que le schéma qui sous-tend nos pratiques est faux. Selon ce schéma, la maladie évoluerait obligatoirement par étapes où le cancer s’étend à partir de la tumeur par contiguïté puis au-delà du sein et se généraliserait avec des métastases. D’où l’idée qu’il faut intervenir le plus tôt possible et qu’une exérèse radicale enraye le développement de la maladie. Ainsi Halsted, un chirurgien nord-américain de la fin du 19ème siècle, dans la lignée de ses prédécesseurs, a affirmé guérir le cancer du sein par une chirurgie très extensive[1]. Les faits lui ont donné tort, une chirurgie conservatrice a donné les mêmes résultats que son intervention. L’échec du dépistage et de la théorie qui lui a servi de base impose de revoir nos pratiques diagnostiques et thérapeutiques et d’élaborer un nouveau schéma de l’histoire naturelle de la maladie plus conforme à la réalité en utilisant de nouveaux paradigmes.
Comment l’analyse des résultats du dépistage démontent la thèse officielle de l’évolution linéaire du cancer ?
Le nombre de cancers détectés (incidence) explose en même temps que le dépistage progresse. Mais alors qu’on trouve beaucoup plus de petits cancers (des lésions infracliniques et un plus grand nombre de petites lésions de moins de 2 cm au lieu de 4cm auparavant), on constate parallèlement que :
- Le nombre de cancers dits avancés (stade II et plus), lui, ne diminue pas. C’est un premier constat fondamental. En effet, en dépistant les cancers plus tôt, on devrait obtenir une baisse des cancers avancés si la maladie avait une évolution linéaire.
- La mortalité des femmes dépistées ne baisse pas comparée aux femmes non dépistées (sauf dans les études randomisées de faible qualité… aujourd’hui largement critiquées).
Conclusion n°1 : nombre de petits cancers diagnostiqués par le dépistage n’auraient sans doute pas évolué !Dans son article de 2006, la revue Prescrire[2] situe le taux de diagnostics en excès (surdiagnostic) entre 30 et 50 %.
Conclusion n°2 : une petite image mammographique ne signifie ni obligatoirement diagnostic précoce ni obligatoirement bon pronostic.
Aujourd’hui, on évoque une légère baisse de la mortalité par cancer du sein, comment l’expliquez-vous ?
La baisse de mortalité observée actuellement dans le monde n’est pas liée au dépistage car elle est identique dans les populations dépistées et non dépistées. Les travaux les plus récents, dont ceux du professeur Philippe Autier épidémiologiste, vice-président de l’International Prevention Research Institute à Lyon, publiés en 2018, confirment l’absence d’effets bénéfiques du dépistage. Les progrès thérapeutiques, la désescalade de l’agressivité thérapeutique, de même que d’autres causes plus indirectes, liées au mode de vie peuvent intervenir.
Cette baisse est apparue en France à partir de 1993, après une longue période de progression de la mortalité. Après correction des effets de la démographie et du vieillissement de la population, le taux de mortalité standardisé par cancer du sein reste cependant élevé. Il est en 2006 très proche de celui de 1970 et aujourd’hui sensiblement au même niveau que celui de 1960.
Pourtant, selon les promoteurs du dépistage, les traitements et le diagnostic précoce auraient permis d’enrayer une hausse de la mortalité liée à une épidémie de cancers du sein.
Doit-on parler d’épidémie ? C’est l’impression que donne le dépistage. On passe effectivement en France de 21.000 cas détectés en 1980 à plus de 50.000 en 2005 mais en même temps le nombre de mammographies pratiquées explose. Contrairement à ce que l’on nous affirme, il ne s’agit que d’une épidémie apparente, liée au surdiagnostic mis en lumière par les études épidémiologiques qui comparent des populations soumises au dépistage à d’autres qui ne le sont pas. Toute opération de dépistage s’accompagne d’une flambée de l’incidence de la maladie mais cette poussée d’incidence constatée à la mise en place du dépistage aurait dû se résorber progressivement dans les années suivantes or elle a perduré justement à cause du surdiagnostic engendré par le dépistage.
Ces diagnostics en excès provoquent une dilution des cancers qui tuent. La proportion de ces derniers dans l’ensemble des cancers diagnostiqués décroît, ce qui donne l’illusion d’un progrès lié à nos pratiques. Autre effet pervers du dépistage, le surdiagnostic produit une augmentation du nombre de femmes dites à risque, risque reporté inutilement sur leur descendance !
Dans votre ouvrage, vous citez plusieurs cas cliniques qui bousculent le dogme.
On peut rappeler ici le cas d’une femme de 39 ans qui consulte pour des douleurs persistantes du dos et du bassin. Le bilan radiologique osseux et la scintigraphie évoquent des métastases osseuses diffuses. L’examen clinique des seins est normal de même que la mammographie de principe. Toutefois, le bilan est complété par une IRM mammaire qui révèle une tumeur de moins d’un centimètre. Donc, l’affirmation qui consiste à dire que plus l’image mammographique est petite meilleur est le pronostic est contredite. L’absence de traduction radiologique d’un cancer n’est pas gage de bon pronostic.
Autre cas, celui d’une patiente avec une masse palpable de 2 cm adhérente à la peau dans le prolongement axillaire du sein. L’analyse au microscope conclut à un carcinome canalaire infiltrant. La patiente refuse le traitement. Deux ans et demi après, tout a pratiquement disparu. La patiente est perdue de vue pendant huit ans puis revient avec à nouveau une masse palpable… Il n’y a donc pas d’évolution linéaire par étapes dans un ordre inéluctable.
J’ajoute néanmoins une remarque importante : un cas clinique a l’intérêt de remettre en question un dogme mais ne suffit pas pour reconstruire une théorie.
Donc le cancer peut spontanément régresser… Est-ce un phénomène courant ?
La régression spontanée est considérée comme exceptionnelle. En réalité, ce qui est exceptionnel, c’est la possibilité de l’observer. Etant donné que l’on traite systématiquement toute personne diagnostiquée, il est difficile de mener ce type d’étude, mais le phénomène du surdiagnostic et les résultats des études autopsiques systématiques nous invitent à penser que cela n’est pas si exceptionnel.
Vous évoquez aussi le problème des cancers de « l’intervalle », ces cancers qui apparaissent entre deux mammographies et qui échappent donc au dépistage.
Dès 1995, Charles Wright et Barber Müller rapportent dans The Lancet[3] que 10 à 15 % des femmes porteuses d’un cancer du sein sont faussement rassurées par la mammographie, leur cancer se révèlera moins d’un an après. Encore une fois, cela contredit la thèse de la progression linéaire selon laquelle le temps moyen de « doublement » serait d’environ 100 jours. Il faudrait ainsi 7 à 8 ans pour passer de la première cellule maligne à une tumeur de 5 mm (20 duplications), 10 ans pour que la tumeur soit palpable.
Par ailleurs, indépendamment de l’évolution de la maladie qui n’est pas celle attendue, la mammographie reste un examen rudimentaire, fait de clichés sans préparation de parties molles, s’appuyant sur une échelle de gris peu contrastée et montrant essentiellement des signes indirects liés à l’environnement de la tumeur. Dès qu’elle a été comparée à d’autres techniques, ses insuffisances sont apparues clairement. Avec les progrès de l’échographie, la multiplication des microbiopsies et le développement de l’IRM dans les années 1990, les cancers du sein invisibles à la mammographie se révèlent d’une ampleur insoupçonnée !
Qui cherche trouve : nous serions nombreuses à être porteuse d’un cancer du sein…
Beaucoup de femmes ont des cellules cancéreuses silencieuses. Cela est confirmé par les études autopsiques réalisées dans une population de femmes sans pathologie mammaire connue. Sur 110 autopsies médicolégales[4] de femmes âgées de 20 à 54 ans, l’étude anatomopathologique (c’est-à-dire l’étude au microscope du sein) découvre des lésions malignes chez 20 % d’entre elles et un cancer invasif chez 2 %. Au total, que les cancers soient in situ ou invasifs, les pourcentages sont énormes et d’autant plus remarquables que l’étude porte sur des femmes jeunes qui n’appartiennent pas aux tranches d’âge où le cancer est le plus fréquent. Bref, toute cellule cancéreuse ne fait pas de nous un cancéreux.
A partir de quand est-on « vraiment » malade ?
La prise de conscience du surdiagnostic impose un changement de paradigme et de nouvelles questions : quand, comment et où commence la maladie évolutive ? Un cancer surdiagnostiqué et un cancer évolutif mortel sont-ils deux maladies différentes ou deux manifestations différentes d’une seule maladie ?
Aujourd’hui, on ne sait pas répondre à ces questions élémentaires tant qu’on s’appuie sur la seule histologie[5] pour faire le diagnostic de cancer. Dans l’état actuel de nos connaissances, il ne suffit pas d’une histologie positive pour faire un malade. La validité de l’examen histologique est bonne pour confirmer ou non une suspicion de maladie cancéreuse fondée sur la dynamique de symptômes, alors qu’elle est mauvaise quand la suspicion résulte de tests de dépistage.
Ce que l’on peut dire à la lumière des résultats du dépistage, c’est que la précipitation diagnostique a été contre-productive, ce qui doit nous inciter à être plus modestes, moins péremptoires dans les choix diagnostiques (dépistage ou pas) et thérapeutiques. Vue notre ignorance, l’écoute des patientes doit prendre une importance particulière.
Le dépistage par autopalpation est-il plus recommandable ?
Non dans la mesure où il contribue aussi au surdiagnostic tout en étant inefficace. Il garde toutefois l’intérêt de ne pas irradier. Dans un essai réalisé à Shangaï d’octobre 1989 à octobre 1991[6] sur près de 270 000 femmes, 130 000 ont été initiées à l’autopalpation sous surveillance médicale et comparées à un groupe témoin (non dépisté). Les taux cumulés de mortalité par cancer du sein après dix à onze ans de suivi étaient similaires dans les deux groupes mais une surmortalité à trois ans a été constatée dans le groupe dépisté.
Cette surmortalité chez les femmes dépistées peut-elle être liée au fait que certains cancers ont une évolution plus défavorable quand ils sont traités plus tôt ?
Cette question « le dépistage peut-il influencer défavorablement l’évolution de certains cancers ? » est importante car depuis le début du XXe siècle on évoque la possibilité d’une inhibition des métastases par la tumeur primitive. Ainsi, en 2005, des chercheurs appartenant à des équipes de plusieurs pays posent la question dans l’European Journal of Cancer : « la chirurgie peut-elle perturber défavorablement l’histoire naturelle d’un cancer du sein débutant en accélérant l’apparition de métastases à distance ? » Cette idée va à l’encontre du schéma classique selon lequel « une avance de 12 mois au moment du traitement diminue de 30% le nombre des patientes qui auraient des métastases ».
Les données contradictoires et les nombreux paradoxes attachés à la pathologie mammaire prouvent au moins une chose, nous ne comprenons toujours pas l’histoire naturelle de la maladie.
Que faire après un diagnostic de cancer du sein par dépistage pour éviter un surtraitement lié à un surdiagnostic ?
Il n’y a aucun moyen de savoir sur le plan individuel si on est victime d’un surdiagnostic ou pas. Le surdiagnostic n’est identifiable ni par le radiologue, ni par le soignant ni par l’anatomopathologiste, ni par la patiente. Pour eux, il n’y a que des diagnostics. Sa réalité est mise en lumière par l’épidémiologie en comparant des populations soumises à un dépistage d’intensité variable.
Le seul moyen d’échapper au surdiagnostic est de ne pas aller à sa rencontre avec le dépistage d’autant plus qu’il n’a pas démontré son efficacité. Une fois le diagnostic histologique posé, dans le contexte actuel, il est impossible de différer le traitement au profit d’une surveillance, bien qu’un traitement plus précoce grâce au dépistage n’ait pas eu d’impact sur la mortalité. Cette dernière constatation rend pourtant éthiquement possibles d’autres attitudes.
Combien de femmes seraient traitées inutilement ?
L’appréciation quantitative du surdiagnostic fait débat, les extrêmes vont de 1 à plus de 50% des cancers diagnostiqués dans le cadre du dépistage, la plupart des études le situent autour de 30 à 50 %.
Les surtraitements sont potentiellement la source d’une mortalité supplémentaire ainsi que les cancers radio-induits liés à l’irradiation mammaire lors des mammographies.
Votre constat à propos des limites du dépistage vaut-il pour d’autres cancers ?
Oui, cela vaut aussi pour les cancers de la prostate, de la thyroïde ou encore le neuroblastome de l’enfant.
Finalement, Hippocrate avait-il raison quand il déconseillait l’interventionnisme sur une tumeur mammaire ?
Le problème n’est pas qu’il ait raison ou tort de ne pas intervenir. Je constate simplement que dans la compréhension de la maladie nous sommes toujours aussi démunis que lui malgré tout notre arsenal technologique
Le coût financier du surdiagnostic
Avec 9 millions de femmes invitées tous les 2 ans, le dépistage organisé coûte environ 215 millions d’euros annuel (chiffre Haute autorité de santé et Ligue contre le cancer[7]). Le traitement du cancer est bien plus onéreux encore, entre 3,2 milliards d’euros (chiffre de 2004 de l’HAS) et 2,3 milliards (2012, Ligue contre le cancer). Difficile de savoir la part du surcoût lié au surtraitement, mais si on se base sur l’estimation de 30% de surdiagnostics, cela pourrait représenter tout de même 1 milliard… Le coût moyen d’un traitement d’un cancer du sein en phase active est de 10 000€ selon la Ligue contre le cancer. Ces chiffres officiels ne comptabilise pas les coûts restant à charge pour les patientes (ni le coût moral évidemment).
Dans son ouvrage, Bernard Duperray livre d’autres quelques chiffres édifiants Outre-Atlantique : selon le président de l’Association médicale du Québec, le docteur Laurent Marcoux, le surdiagnostic représenterait un coût pour le système de santé de 5 milliards de dollars sur un budget qui compte plus de 30 milliards au Québec. Aux États-Unis, le surdiagnostic a englouti entre 158 et 226 milliards de dollars en 2011, selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.
[1] Ablation du sein, des muscles et des ganglions, entrainant parmi les effets secondaires un gros bras.
[2] Mammographie et dépistage des cancers du sein. Prescrire, mai 2006.
[3] Wright CJ, Mueller CB. Screening mammography and public health policy:
the need for perspective. The Lancet. 1995
[4] Nielsen M, Thomsen JL et al. Breast cancer and atypia among young and
middle-aged women: a study of 110 medicolegal autopsies. British Journal of
Cancer. 1987
[5] L’histologie, autrefois appelée anatomie microscopique, est la branche de la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques.
[6] Thomas DB, Gao DL et al. Randomized trial of breast self-examination in Shanghai:
final results. Journal of the National Cancer Institute. 2002 Oct 2;94(19):1445-57.
[7] https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_2014.pdf
Articles complémentaires
Mots-clefs : Bernard Duperray, cancer du sein, dépistage, interview, surdiagnostic
